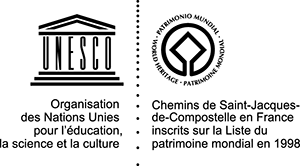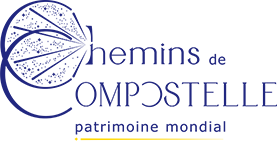-
Tue 24 OctExposition"Campus Stellae, le champ de l'étoile "
+ en savoir plus
a_en
EN Édifiée au XIIe siècle
Endommagée par la guerre de Cent ans, reconstruite au XVe siècle
Protection Monuments Historiques en 1898
Bâtiments abbatiaux retouchés au XVIIe puis au XIXe siècle
Travaux à la fin du XXe siècle pour rendre son rôle d’accueil à l’abbaye (auberge de jeunesse)
EN L’abbaye de Cadouin fut fondée en 1115, dans le bas Périgord, au creux d’une petite vallée de la forêt de la Bessède. Durant près de sept siècles, ce monastère cistercien fut le but d’un important pèlerinage dédié au Saint-Suaire. Cette éminente relique, censée avoir enveloppé la tête du Christ après sa mort, faisait l’objet d’une vénération soutenue et d’un important pèlerinage. Une centaine de miracles, recensés essentiellement durant la guerre de Cent ans (1337-1453), lui ont été attribués. Ces derniers font état de guérisons, de résurrections, de sauvetages, de libérations et d’apaisements de phénomènes naturels.
La légende raconte que le Saint Suaire fut dérobé au lendemain de la Passion du Christ, par un juif converti. Après être resté dans sa famille durant cinq générations, le précieux linge tomba aux mains du calife Muawiya Ier, ancien secrétaire de Mahomet et fondateur de la dynastie sunnite des califes Omeyades, qui jeta le linceul au feu a n de déterminer qui serait son propriétaire. Le tissu s’éleva au-dessus du bûcher et retomba sur la tête des chrétiens, tranchant ainsi la question. Il fut ensuite récupéré à Antioche lors de la Première croisade (1096-1099), et transporté en Périgord. La première église où se trouvait le Suaire fut détruite par un incendie, mais il fut miraculeusement épargné par les ammes et remis aux moines de l’abbaye de Cadouin en 1117.
Voilà pour la légende. Pour ce qui est de l’histoire, la présence du Saint Suaire à Cadouin n’est attestée qu’en 1214 par un acte de Simon de Montfort. La précieuse relique assura à l’abbaye rayonnement et prospérité, notamment aux XIIe et XIIIe siècles, pendant la seconde moitié du XVe siècle et au début du XVIe siècle. A chaque période troublée,
le Suaire put être mis en lieu sûr : lors de la guerre de Cent ans, il fut transféré à la basilique Saint-Sernin de Toulouse, où il fut l’objet d’une grande ferveur, et y resta de 1392 à 1455 ; il survécut aux protestants qui manquèrent de détruire l’abbaye ; il fut caché pendant la Révolution. Et même près de deux siècles après, la persistance de la dévotion à cette relique permit à l’abbaye de connaître un important renouveau,
à tel point qu’en 1866, les ostensions reprirent : munie de torches, la foule de dèles s’approchait pour voir la relique extraite pour l’occasion de son co re doublé de soie rouge et étendue sur le drap d’or d’Anne de Bretagne. Mais au XXe siècle, l’authenticité du Suaire fut mise en doute, et en 1934, les résultats de l’expertise mirent un coup d’arrêt dé nitif aux dévotions.
Le vénéré Suaire s’avéra en e et n’être qu’une vulgaire éto e musulmane de la n du XIe siècle. Vulgaire ? Pas tant que ça... Si e ectivement, tout mysticisme s’e ace devant cette révélation, le tissu que possède l’abbaye de Cadouin demeure néanmoins très précieux : il est l’un des deux seuls vestiges quasi intacts de l’art textile de l’époque fatimide (969-1171). A l’origine, ce tissu quasi complet de lin écru très n lé à la main et orné de broderies de soie polychromes, daté entre 1094 et 1099, était sans doute un voile d’apparat, destiné à être porté sur les épaules comme un châle. C’est pourquoi les historiens estiment fort probable qu’il ait en réalité été un luxueux cadeau o ert aux croisés par la délégation égyptienne lors du siège d’Antioche occupée par les Turcs (1098).
De nos jours, cette éto e que l’on appelle encore le suaire est précieusement conservée dans la salle capitulaire du cloître, qui fait désormais o ce de musée, et présentée dans une vitrine climatisée.
L’abbaye de Cadouin était un important sanctuaire régional, renommé et fréquenté pour sa prestigieuse relique du Saint-Suaire. Elle est donc aujourd’hui un solide témoin de ce que fut la pratique des pèlerinages au Moyen-Age. En tant qu’abbaye obéissant à la règle de saint Benoît, elle avait pour fonction d’accueillir les pèlerins, d’où qu’ils viennent, et où qu’ils aillent. Toutefois, les archives étant muettes à ce sujet, il est impossible de dire combien de pèlerins en route pour Compostelle ont pu faire étape à l’abbaye de Cadouin, mais il est tout aussi impossible de dire qu’aucun jacquet ne s’y soit arrêté pour y faire ses dévotions.